
En 1975 sort Les Dents de la mer, 1er grand succès du réalisateur Steven Spielberg. Surfant sur la vague des films d’action et d’épouvante, il dresse avec brio une œuvre populaire, mais pleine d’un style nouveau, entre influence du passé et regard novateur. Ce thriller prend racine dans la station balnéaire d’Amityville, une charmante bourgade que l’apparition d’un requin transformera en bain de sang… Les plans d’ouverture du film en annoncent la couleur. Sous l’eau, la caméra navigue fluidement à travers les algues, fait corps avec le bleu profond qui l’entoure. Loin d’être décoratifs, ces premiers plans sont la vue subjective du futur cauchemar d’Amity, une terreur qui donnera un ton particulier, celui d’un bleu azur imprégné de pourpre. Bien vite, nous devinons le danger qui se tapit sous les eaux paradisiaques ; tout nous pousse à traquer le moindre signe inhabituel, dans un état de perpétuelle alerte. C’est là que le film se montre particulièrement habile : tout le suspense du film est basé sur l’attente.
L’action, censée prendre les devants grâce aux initiatives du chef de police Martin Brody (Roy Scheider), est vite stoppée par le maire aux intentions tout autres, centré davantage sur le profit touristique que sur l’intérêt humain. Cet engourdissement deviendra létal quand un deuxième meurtre aura lieu, sous les yeux interdits de Brody. Au cours d’une sortie en famille à la plage, le protagoniste, inquiet de savoir la présence d’une menace que tous ignorent, ne peut s’empêcher de scruter la mer. Hélas, sans cesse perturbé par les gens qui fourmillent, son attention est tantôt sollicitée et sa vue obstruée. Le regard de Brody dirige le nôtre, faisant ainsi grimper notre impatience et notre angoisse. Plusieurs personnes passent devant lui ; la caméra, elle, se rapproche par un jump cut vif et rapide à chaque passage, en plan toujours plus serré. Dotée d’une mise en scène rappelant celle d’Hitchcock, la séquence nous tient en haleine jusqu’au vertigineux effet vertigo, qui, comme dans les films signés par le maître du suspense, traduit la peur lorsqu’elle saisit l’esprit. De plus, le film possède un aspect psychologique subtil mais non négligeable qui se rapproche des thématiques favorites du cinéaste britanno-américain. Ici, l’œuvre brise le quotidien idyllique par la concrétisation horrifique d’une menace jusqu’ici reléguée au rang de mythe.
L’imaginaire des enfants voit le risque comme un jeu, les créatures monstrueuses comme des adversaires inoffensifs. L’un des enfants de Brody présente une de ses blessures comme « la morsure d’un vampire », d’autres enfants jouent sur des bornes d’arcade à des jeux de « requins tueurs ». Innocents et mal avertis, ce seront une adolescente et un enfant qui seront les premiers à succomber aux dents longues et bien réelles du monstre marin qu’est le requin. Une naïveté qui déteint d’ailleurs sur les adultes en proie à des comportements aussi ridicules qu’inconscients. Encouragés par le profit financier ou l’excès de confiance, les adultes se pensent protégés par leur soudaine hardiesse. Ignorant l’inconnu, le courageux héros, accompagné d’un spécialiste de l’institut océanographique, Matt Hooper (Richard Dreyfuss), venu pour l’aider dans sa tâche, se donne pour mission d’aller ensemble chasser le requin en pleine nuit. Hélas, si la boisson leur a donné le courage d’aller en mer, elle ne leur a pas pour autant prodigué une immunité face à la mort. Bien vite, ils se retrouvent impuissants, forcés de battre en retraite. Prenant leçon de leurs lacunes, ils joignent à leur seconde expédition Quint, un vieux loup de mer (Robert Shaw).

Entouré désormais de deux acolytes alliant savoir et expérience, Brody s’engage encore une fois contre la peur qui contamine la station balnéaire. L’affrontement périlleux avec le requin est un succès en demi-teinte : si les plans et la bande son culte nous embarquent avec le trio, il est difficile de rester à bord avec tant de turbulences scénaristiques. Quint, aussi méprisant que méprisable par son agaçant étalage d’expérience, s’avère d’une inutilité navrante lors de ce face-à-face musclé. Ses pièges infaillibles périssent en même temps que lui, tandis que l’expert des requins, attendant son heure pour mettre en place sa stratégie, échoue et s’évapore, laissant le pauvre Brody aquaphobe en charmante compagnie. Contre toute attente, il réussit avec une surprenante rapidité et à l’aide d’une méthode aussi efficace qu’inattendue à pulvériser le requin, au sens propre du terme. Ainsi, il vainc son traumatisme d’enfance et annihile sa peur personnelle en même temps que l’angoisse collective qui gangrénait la petite ville. Tout est bien qui finit bien, le requin n’est plus, le brave scientifique émerge soudainement après avoir brillé par son absence et ensemble ils nagent vers le calme retrouvé de l’île, loin du large et de la peur.


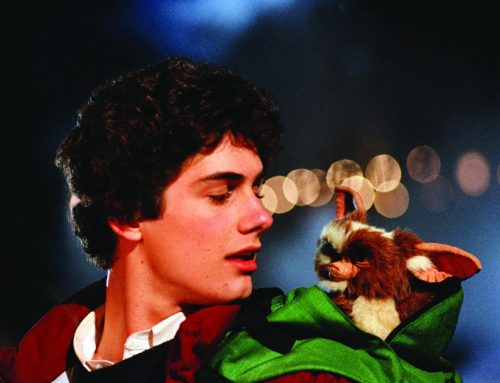


Laisser un commentaire